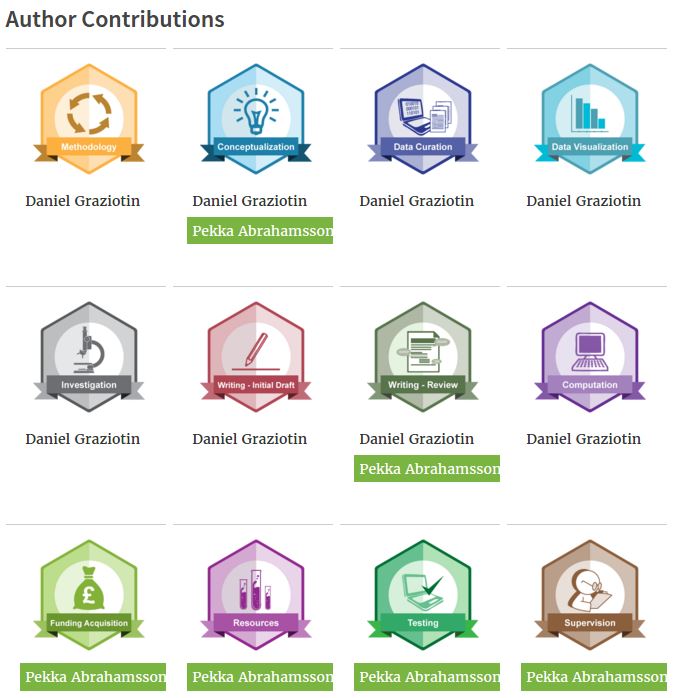« Qui se laisse séduire par les fausses nouvelles ? » À la question du journaliste Nicolas Bérubé, titre d’un article dans La presse, je suis bien obligé de répondre « moi » et j’en ai honte.
Même après une quinzaine d’années à suivre l’actualité universitaire et scientifique pour notre veille en pédagogie, même avec une maîtrise en études des médias et après avoir enseigné à des étudiantes et étudiants en communication à toujours se demander à qui profite une nouvelle… Je confesse avoir crû qu’on avait réussi à ramener une espèce préhistorique à la vie. J’aurais certainement dû consulter la vérification des faits de Science-presse qui conclut que: « Les « loups » élevés par la compagnie Colossal Biosciences ne sont pas des loups sinistres, mais plutôt des loups gris génétiquement modifiés pour leur ressembler. On est encore loin de la « désextinction » ou de la « résurrection » d’une espèce disparue. »
Cette nouvelle-là, je l’ai gobée tout rond et j’ai commencé à en parler avec mon entourage comme si c’était une réalité scientifique. Il aura fallu le titre d’une infolettre du magazine web Medium plus d’un mois plus tard pour que je comprenne mon erreur. En quelques phrases, l’autrice Anna Dorn résume bien mon problème : « Que se passe-t-il lorsque nous confondons progrès scientifique et storytelling de marque et que nous croyons les gros titres plutôt que le génome ? »
« [Le biostatisticien Liv] Dobbs prévient que lorsque les entreprises surestiment les réalisations scientifiques, elles brouillent la frontière entre l’innovation et l’illusion. [Le généticien Sam] Westreich est encore plus direct : [la nouvelle de l’entreprise Colossal Biosciences] n’a rien à voir avec la conservation, mais elle vise plutôt à attirer des investisseurs.
L’idée de la dé-extinction est émotivement chargée. Elle présente l’extinction comme un défi technique et non comme une perte définitive. Elle donne l’impression que le passé est modifiable. Mais des projets comme celui de Colossal risquent de transformer un véritable deuil écologique en un spectacle biotechnologique. » (traduit avec DeepL.com, puis adapté; nos emphases)
Je me suis bien demandé pourquoi j’ai été berné si facilement et pourquoi dans ce cas-ci je ne suis pas allé voir plus loin que les grands titres…
- D’abord, parce que je ne connais à peu près rien à la génétique et que je suis un peu paresseux lorsqu’on atteint ces niveaux de complexité scientifique. Je suis donc assez facilement impressionnable. La science-fiction de Jurassic Park et la réalité se confondent pour moi.
- Ensuite, j’ai l’impression qu’à l’ère de l’intelligence artificielle et avec la rapidité des changements technologiques, presque tout m’apparaît désormais réalisable pour la science.
- Enfin, je crois que je suis assez pessimiste quant à l’éthique de nombreux chercheurs… Je suis victime d’un biais de confirmation: Si on annonce que des chercheurs ont enfreint une limite éthique, ce doit être vrai…
Ce qui me ramène à l’article de Bérubé, qui résume l’étude « Profiling Misinformation Susceptibility » (paru dans Personality and Individual Differences (241) 2025), réalisée auprès de plus de 66 000 personnes dans 24 pays. Un des auteurs, le professeur Friedrich M. Götz de l’Université de Colombie-Britannique explique notamment que…
« Les personnes ayant fait des études universitaires ont obtenu de meilleurs résultats [à discerner les fausses nouvelles] que les répondants ayant fait de moins longues études. Mais elles ont aussi surestimé leur capacité à identifier la désinformation […]. L’idée que les personnes douées pour quelque chose puissent penser qu’elles sont meilleures qu’elles ne le sont en réalité est aussi vieille que l’humanité elle-même. Cela nous rappelle que nous sommes tous vulnérables, peu importe nos compétences, notre niveau d’instruction ou nos réalisations. » [cité dans Bérubé (2025), notre emphase]
La bonne nouvelle? « …[T]outes générations confondues, la génération Z percevait sa capacité de discernement de la désinformation avec la plus grande précision, malgré ses plus mauvais résultats au test. Détecter la désinformation est à la fois une responsabilité sociale et individuelle, dit M. Götz. « À cette fin, la prise de conscience de sa propre vulnérabilité – que nous observons chez de nombreux jeunes adultes aujourd’hui – et le désir de faire quelque chose pour y remédier sont des conditions préalables essentielles [pour ne plus se laisser berner]. » [cité dans Bérubé (2025), nos emphases]
Si les jeunes adultes qui se présentent sur nos campus sont « conscients de leur vulnérabilité » et « désirent faire quelque chose pour remédier » à leur faible discernement de la désinformation, que leur offrirons-nous pour qu’ils y parviennent?
Sources:
Bérubé, Nicolas (11 mai 2025), « Qui se laisse séduire par les fausses nouvelles ? », La presse, Montréal.
Champagne, Éric-Pierre (10 avril 2025), «Le loup de Game of Thrones ramené à la vie ? », La presse, Montréal.
Couillard, Kathleen (10 avril 2025), «Vérification éclair : un loup préhistorique ramené à la vie? Faux », Science-Presse, Montréal.
Dorn, Anna (15 mai 2025), « No, dire wolves are not back from extinction », The Medium Newsletter, San Francisco.