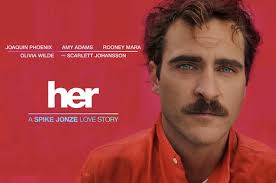Le 15 mai 2025, Sophie Meyer, directrice des études au Cégep de Sherbrooke, est venue répondre à certaines questions de notre vice-rectrice aux études et aux relations internationales, Christine Hudon. Sous le thème « Quelles sont les caractéristiques et aspirations des présentes cohortes au Cégep de Sherbrooke? », cet conférence/entretien a permis de dresser les contours de ce que pourrait être la prochaine génération d’étudiantes et d’étudiants universitaires. Voici, en rafale, quelques éléments que j’en ai retenus…
Leurs cheminements aux études :
- 55 % évoluent dans des programmes pré-universitaires;
- 38 % évoluent dans des programmes techniques, mais s’y inscrivent par intérêt, même s’ils prévoient poursuivre leurs études vers l’université;
- Des diplômés des programmes techniques se retrouveront dans les cohortes universitaires, augmentant la diversité des profils dans les bac. (informatique, génie, travail social, etc.)
- Les 7 % restant sont inscrits au Tremplin DEC. Il s’agit d’un cheminement orientant (max. 3 semestres) qui permet notamment d’explorer certains programmes, d’obtenir des préalables ou de favoriser un retour progressif aux études.
- 25 à 30 % poursuivront effectivement vers des études universitaires.
- 70 % travaillent en même temps qu’ils étudient.
- 50 % travaillent plus de 15 h/ semaine
- 20 % à 30 % travaillent plus de 20 h/ semaine
- Les études collégiales s’allongent, notamment compte tenu d’allégements et de changements de programmes…
- De 2,5 à 3 ans pour les programmes de deux ans;
- De 3,5 à 4 ans pour les programmes de 3 ans.
Ce qui les mobilisent :
- Leurs situations financières (plutôt qu’une certaine éco-anxiété);
- Les programmes d’aide financière sont peu flexibles, si bien que la décision d’allonger les études mène parfois à des échecs.
- La crise du logement; les questions de transport;
- Les questions relatives à la diversité sexuelle et de genre.
- Mme Meyer nous rassure en nous indiquant qu’elle n’observe pas au Cégep les reculs quant à ces questions que les médias constatent parfois au niveau secondaire.
Leurs défis :
- Vivent des stress importants, voire de l’anxiété relativement aux transitions interordres, à l’obtention de la bonne « Cote R »; anxiété de performance (collaboration vs. compétition);
- Difficultés d’orientation;
- Difficultés d’organisation de leurs horaires (temps d’études, etc.) – embauche d’un technicien en adaptation scolaire qui ne fait que rencontrer des personnes étudiantes pour les soutenir à ce niveau… et son horaire déborde;
- Faible maîtrise des outils informatiques (ne sont pas technos) – ils ont parfois de la difficulté à manier clavier et souris (vs. téléphones et tablettes tactiles);
- Enjeux de littératie, de numératie (pénuries d’enseignants au secondaire?);
- Moyens de soutien à la réussite mis en place pour l’épreuve de français nécessaire à obtenir le DEC.
- La question de l’IA…
- Levée de boucliers initiales au Cégep, notamment par craintes du plagiat (demandes reçues par la direction d’empêcher l’IAg d’entrer au Cégep).
- On est à revoir les stratégies d’évaluation.
- On constate une bascule progressive des questions d’intégrité vers des situations d’apprentissage intégrant l’IA.
- Développement d’outils pour les personnes enseignantes et étudiantes.
- Le marché du travail s’attend à ce que les diplômés soient aptes à se servir des IA.
- Toutes les professions vont devoir s’adapter.
- Mme Meyer souligne l’importance que les universités et les cégeps s’arriment.
- Levée de boucliers initiales au Cégep, notamment par craintes du plagiat (demandes reçues par la direction d’empêcher l’IAg d’entrer au Cégep).
Leurs forces :
Contrairement à certaines images médiatiques…
- Mme Meyer observe un grand civisme (des personnes étudiantes la saluent, lui tiennent la porte, même si elle ne porte pas de charge, etc.);
- Elle les trouve résilients, malgré une importante « anxiété pédagogique » (ils persévèrent; ils s’accrochent).
- Ce que certains voient comme de l’égocentrisme, Mme Meyer le qualifie de « bienveillance envers eux-mêmes ». Par exemple, ils choisiront parfois de ne pas vivre une évaluation s’ils ne croient pas être en condition pour l’accomplir correctement. Évidemment, cela entraîne d’autres enjeux au niveau des horaires, de la triche, etc.
- On constate une différence dans le rapport aux études des jeunes garçons et filles.
- Si les étudiantes acceptent d’étudier même si un sujet a moins de sens pour elles, les étudiants masculins ont besoin de concret.
- On envisage des parcours « masculins » où les activités pédagogiques montrent systématiquement à quoi va servir ce que l’on apprend.
- Ils s’engagent sur différents comités en fonction de leurs intérêts. Ils ne sont pas passifs, ne sont pas que des observateurs.
- Des plans de réussite personnalisés produisent des « perles étudiantes ».
Leur vision de l’avenir :
Ils sont l’une des premières générations depuis la seconde guerre mondiale qui sait qu’elle n’aura pas facilement accès à la propriété et dont les revenus pourraient être inférieurs à ceux de leurs parents.
Ils ne sont pas non plus prêts à passer leurs vies à travailler.Par conséquent, le SENS des études constitue un enjeu particulier pour eux.